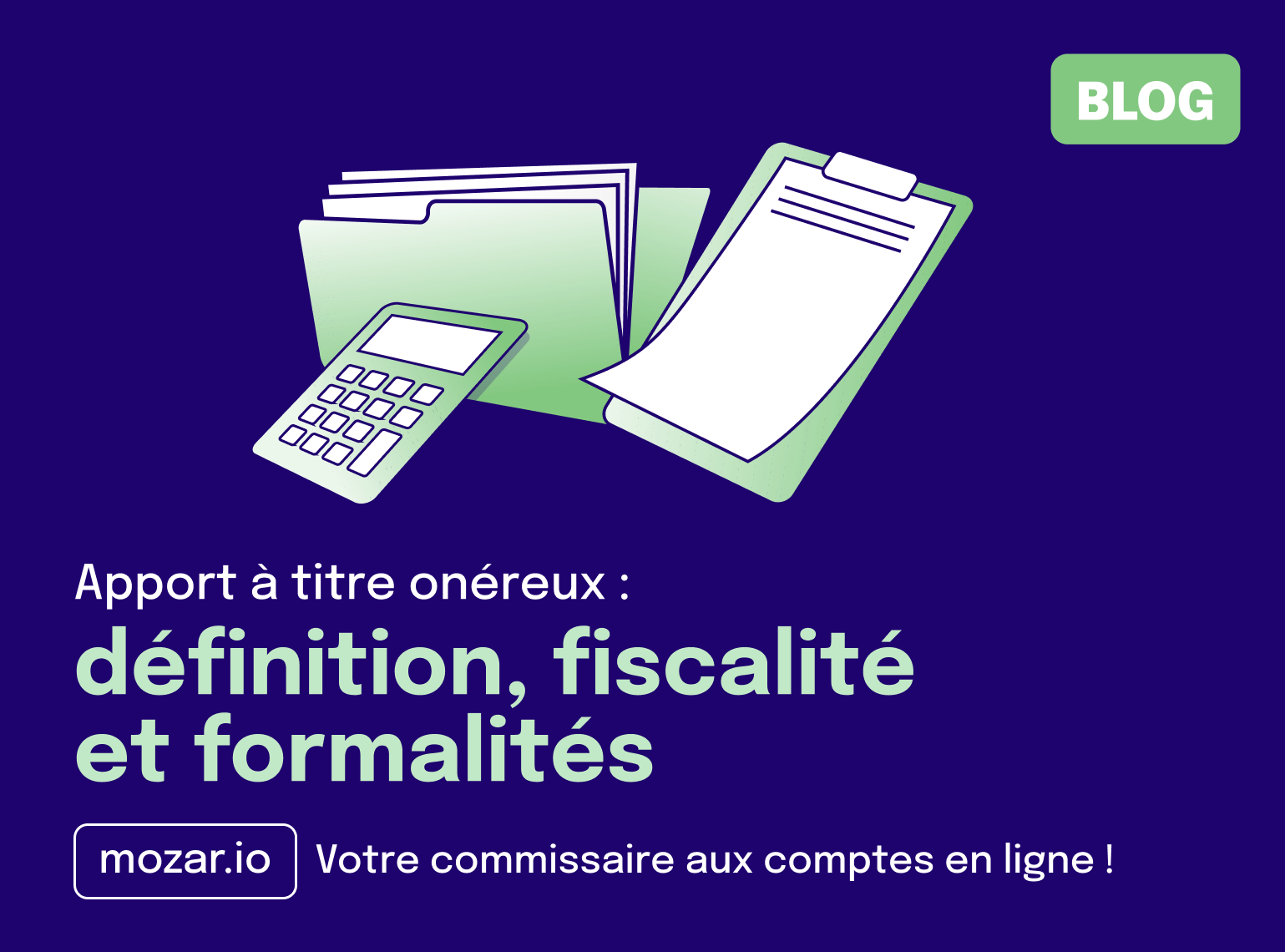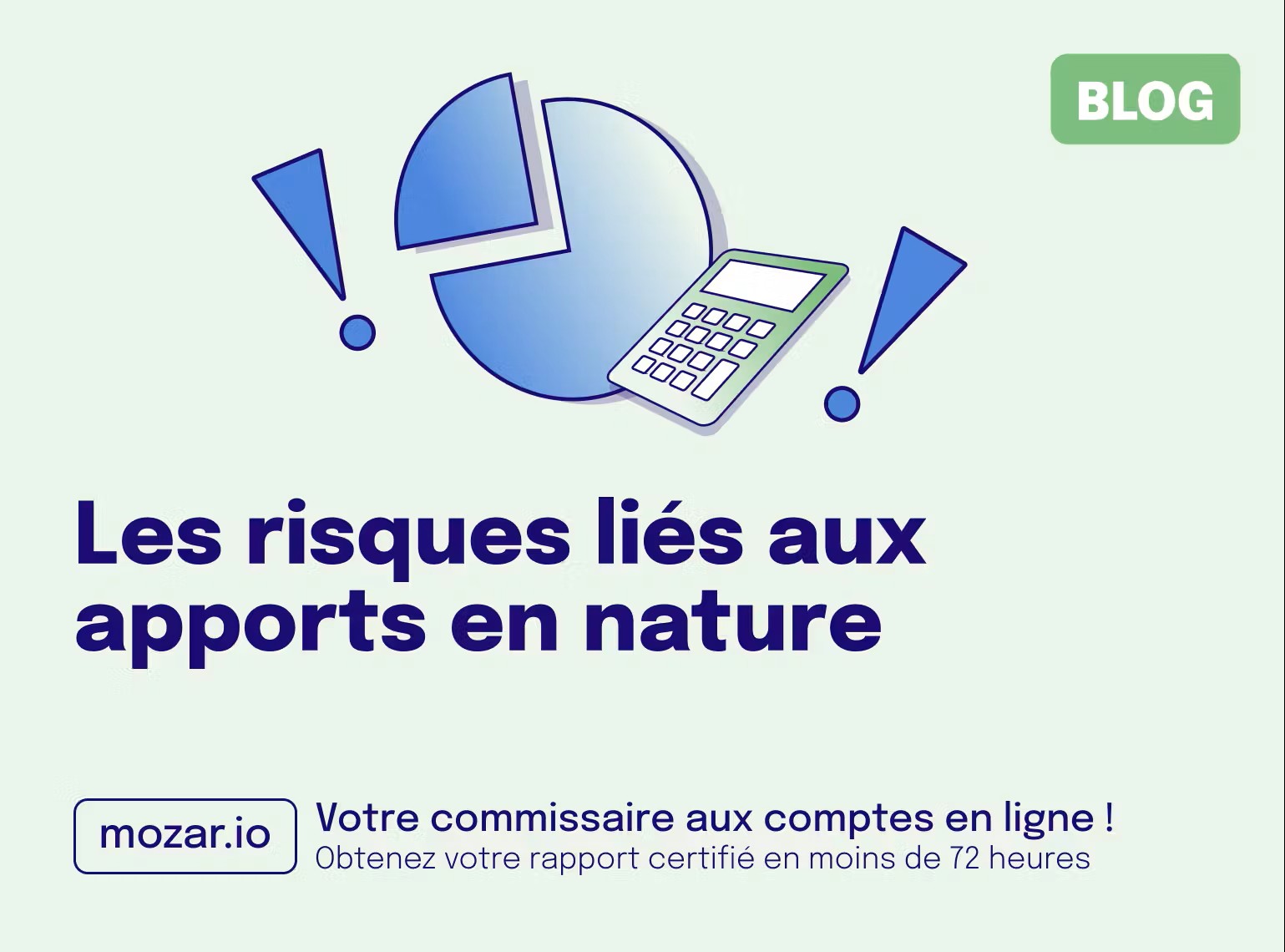L’apport à titre onéreux est une opération juridique encore méconnue, mais fréquente dans la vie des sociétés. Il s’inscrit dans la grande famille des apports réalisés par les associés lorsqu’ils créent ou modifient le capital d’une société. Ni totalement gratuit, ni totalement assimilable à une vente, l’apport à titre onéreux peut avoir des implications fiscales et juridiques significatives pour la société et l’apporteur. Il est donc essentiel d’en comprendre les contours, les avantages, les risques et les démarches à suivre pour le réaliser correctement.
Dans cet article, nous vous guidons pas à pas, exemples à l’appui, pour bien distinguer cette opération des autres formes d’apport et éviter les pièges. Que vous soyez dirigeant de TPE, expert-comptable, avocat ou investisseur, ce guide vous aidera à sécuriser votre apport… et potentiellement à optimiser sa fiscalité.
Qu’est-ce qu’un apport à titre onéreux ?
Définition et distinction avec les autres formes d’apport
Lorsqu’un associé entre dans une société, il peut y apporter des ressources de trois natures différentes : en numéraire (argent), en nature (biens physiques ou incorporels) ou en industrie (compétences, travail). En contrepartie, il reçoit des parts sociales ou des actions.
L’apport en nature est celui qui porte sur un bien autre que de l’argent : immeuble, véhicule, fonds de commerce, titres financiers, etc. Par défaut, cet apport est dit pur et simple : la société attribue à l’associé des droits sociaux en échange du bien, sans autre contrepartie.
L’apport à titre onéreux, en revanche, est une forme particulière d’apport en nature. Il se caractérise par le fait que la société ne rémunère pas uniquement l’apporteur en parts sociales : elle peut aussi lui verser une somme d’argent ou reprendre un passif lié au bien. Autrement dit, la société “achète” partiellement le bien apporté, ce qui entraîne des conséquences spécifiques, notamment fiscales.
À noter : lorsque l’apport combine les deux modalités (parts sociales + reprise de dettes), on parle d’apport mixte.
Exemple concret pour comprendre
Prenons l’exemple d’un associé qui apporte un immeuble d’une valeur de 200 000 € à une SAS en cours de création. Ce bien est grevé d’un emprunt immobilier de 80 000 € que la société accepte de reprendre à sa charge.
- La société émet 120 000 € de capital en actions en faveur de l’associé (rémunération pur et simple).
- Et elle reprend les 80 000 € de dettes bancaires (rémunération à titre onéreux).
Dans ce cas, l’opération est bien un apport mixte, dont une partie est qualifiée à titre onéreux.
Pourquoi cela change-t-il tout ? Parce que la reprise de dette par la société est assimilée à une vente partielle, ce qui entraîne l’application de certains droits fiscaux, notamment les droits d’enregistrement à titre onéreux (comme lors d’une vente classique). Et cela implique aussi une analyse rigoureuse par un commissaire aux apports, pour éviter toute requalification.
Ainsi, la distinction entre apport pur et simple, apport à titre onéreux et apport mixte n’est pas simplement théorique : elle a des conséquences pratiques très concrètes sur la rédaction des statuts, la gestion fiscale de l’opération et les formalités à accomplir.
Pourquoi réaliser un apport à titre onéreux ?
Optimisation de la structure de capital
L’apport à titre onéreux permet à une société d’intégrer un bien (immobilier, matériel, titres…) dans son patrimoine tout en limitant l’émission de nouveaux titres. Plutôt que de diluer excessivement le capital avec un apport pur et simple, la société peut choisir de reprendre une partie du passif lié au bien. Cela permet de préserver l’équilibre capitalistique, ce qui peut être stratégique pour les fondateurs ou investisseurs existants.
Cette solution est souvent utilisée dans le cadre de restructurations, de créations de holdings ou d’optimisations patrimoniales, notamment dans les groupes familiaux.
Allègement de la dette personnelle de l’apporteur
Du point de vue de l’apporteur, cette opération permet de transférer une charge (emprunt, dette fournisseur, passif social) à la société. Cela peut contribuer à améliorer son bilan personnel ou celui de sa structure initiale (ex : entreprise individuelle transformée en société).
Il s’agit donc d’un levier utile dans de nombreuses situations : transmission d’activité, anticipation d’une cession future, ou tout simplement sécurisation de son patrimoine.
Cas d’usage typiques
- Création de holding familiale avec reprise du prêt immobilier attaché à un immeuble professionnel
- Apport d’un fonds de commerce grevé d’un crédit-bail à une nouvelle société
- Apport de titres d’une filiale avec dette intra-groupe
Dans tous ces cas, l’apport à titre onéreux permet une intégration souple du bien, avec une charge supportée par la société au lieu de l’apporteur.
Quelles sont les conséquences fiscales ?
Imposition aux droits d’enregistrement
L’un des principaux effets de l’apport à titre onéreux est l’application des droits d’enregistrement, comme s’il s’agissait d’une vente.
Le taux et le régime applicable dépendent de la nature du bien :
- Biens immobiliers : droits de mutation à titre onéreux (DMTO) au taux global de 5,09 % (variable selon le département)
- Fonds de commerce : taux progressif entre 0 % et 5 % au-delà de 200 000 €
- Titres sociaux :
- 0,1 % pour les actions
- 3 % pour les parts sociales, avec abattement de 23 000 €
Ces droits sont dus uniquement sur la fraction onéreuse de l’apport, c’est-à-dire la part correspondant à la dette reprise ou à la somme versée.
TVA et plus-values
L’apport à titre onéreux peut également être soumis à la TVA, en fonction de la qualité de l’apporteur (assujetti ou non) et de la nature du bien.
Quant à la plus-value, elle est déterminée comme dans une vente classique. Si le bien a pris de la valeur depuis son acquisition, l’apporteur pourra être redevable de l’impôt sur la plus-value (notamment immobilière ou professionnelle).
Il convient donc de bien anticiper cette fiscalité, parfois lourde, avec un conseil juridique et fiscal adapté.
Quelle procédure suivre pour sécuriser l’opération ?
Évaluation du bien apporté
Avant toute chose, le bien doit être valorisé de manière précise et justifiable. En cas d’apport à une société nouvellement constituée, ou si l’apport est significatif dans une société existante, il est fortement recommandé – et parfois obligatoire – de nommer un commissaire aux apports.
Ce professionnel indépendant :
- évalue le bien selon des méthodes reconnues (valeur vénale, coût de remplacement, rentabilité…),
- vérifie la cohérence de la reprise du passif,
- et rédige un rapport circonstancié joint aux statuts ou à l’AG.
Chez Mozar, cette mission est entièrement digitalisée, avec un rapport livré sous 72h et conforme aux exigences légales.
Rédaction des statuts et formalités
L’apport à titre onéreux doit être clairement mentionné dans les statuts ou dans un acte séparé (traité d’apport). Le document doit détailler :
- la nature du bien apporté,
- sa valeur,
- les dettes reprises par la société,
- et la répartition entre fraction pur et simple / fraction onéreuse.
Une fois les statuts signés, les formalités de publicité et d’enregistrement doivent être réalisées (notamment au greffe du tribunal et au service de l’enregistrement si droits dus).
Conclusion
L’apport à titre onéreux est un outil structurant, au carrefour du juridique, du fiscal et du stratégique. Il permet d’intégrer efficacement un actif à une société tout en transférant une partie du passif. Mais cette souplesse a un coût : droits d’enregistrement, TVA, plus-values, commissaire aux apports… autant d’éléments à maîtriser pour éviter toute mauvaise surprise.
Dans ce contexte, faire appel à un tiers de confiance comme Mozar permet de sécuriser l’opération à chaque étape. Grâce à sa plateforme 100 % digitale, Mozar accompagne les dirigeants dans leurs démarches d’apport, de transformation ou de structuration juridique complexe. En moins de 72 heures, avec un accompagnement personnalisé, votre opération est conforme, rapide et sans stress.
Pour aller plus loin : vous pouvez réaliser une simulation gratuite et obtenir un devis immédiat sur mozar.fr.
Questions fréquentes
Quelle est la différence entre un apport pur et simple et un apport à titre onéreux ?
Un apport pur et simple est rémunéré exclusivement par des droits sociaux (parts ou actions), tandis qu’un apport à titre onéreux est partiellement ou totalement rémunéré autrement : soit par le versement d’une somme d’argent, soit par la prise en charge d’un passif par la société. Ce dernier implique une fiscalité proche de celle d’une vente.
Quels sont les droits d’enregistrement applicables ?
Cela dépend du bien apporté et de la part onéreuse de l’opération. À titre indicatif :
- Immeuble : 5,09 % sur la part onéreuse
- Fonds de commerce : jusqu’à 5 %
- Actions : 0,1 %
- Parts sociales : 3 %, avec abattement
Faut-il un commissaire aux apports pour un apport à titre onéreux ?
Dans la majorité des cas, oui. Sauf exceptions (apport en société déjà constituée + décision unanime + valeur < 30 000 €), la nomination d’un commissaire aux apports est requise. Ce dernier sécurise l’opération et évite les requalifications fiscales ou juridiques.
Peut-on apporter un bien grevé d’un crédit en cours ?
Oui, c’est même un cas typique. La société peut reprendre tout ou partie du crédit lié au bien. Mais attention : la fraction reprise est considérée comme une rémunération à titre onéreux, donc soumise aux droits d’enregistrement.
Comment optimiser fiscalement un apport à titre onéreux ?
Voici quelques pistes :
- Bien évaluer la valeur du bien pour ne pas surestimer la part onéreuse
- Fractionner l’apport (pur et simple vs onéreux) pour limiter les droits dus
- Choisir la bonne forme sociale pour réduire les taux (par ex. actions vs parts sociales)
- Anticiper la plus-value et vérifier les exonérations possibles